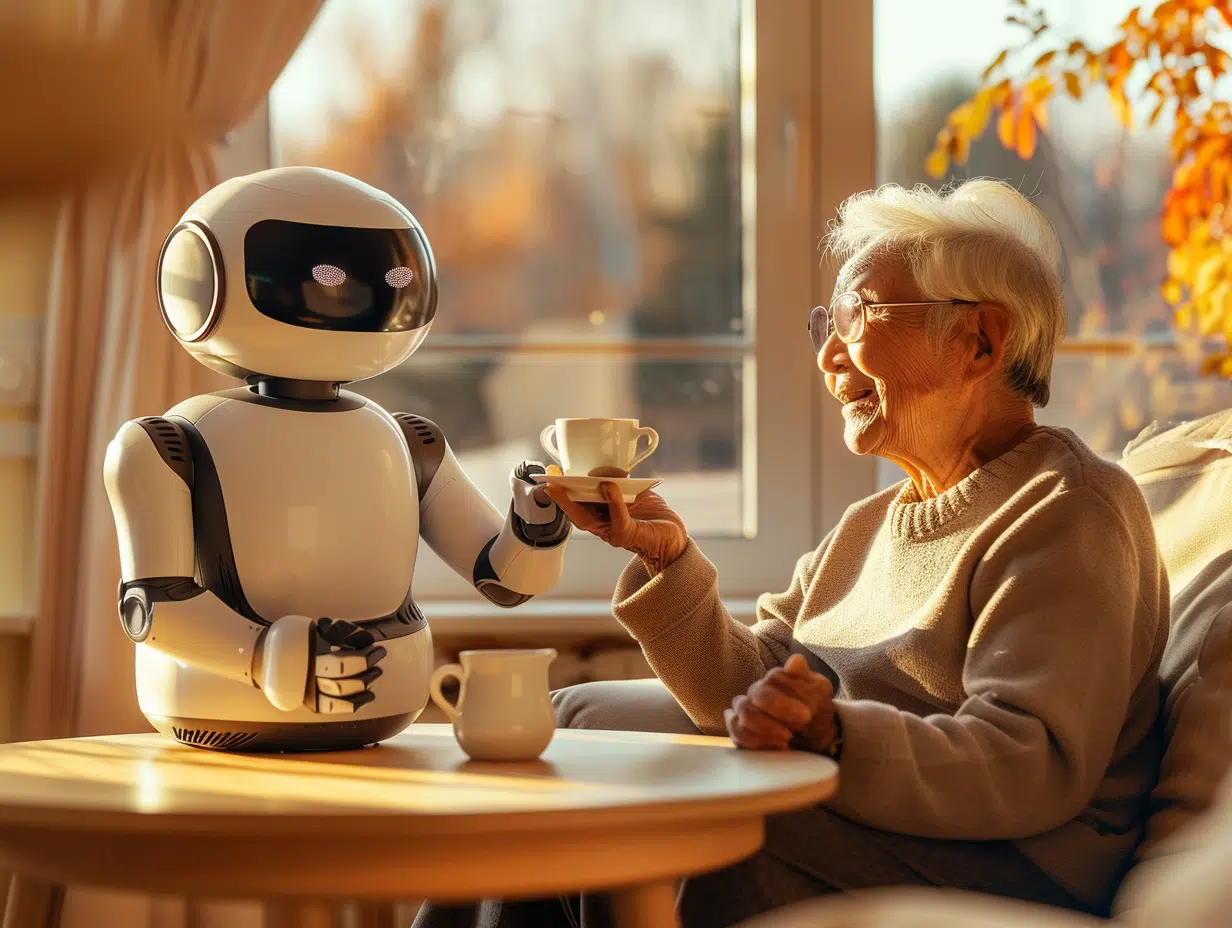Un salarié ayant commencé à travailler avant 20 ans peut, sous certaines conditions, partir à la retraite dès 60 ans. La réforme de 2023 a modifié les critères d’accès à ce dispositif, allongeant la durée de cotisation requise et restreignant l’éligibilité à certains profils. Les carrières longues, les périodes assimilées et la validation des trimestres font désormais l’objet de calculs précis, parfois contestés lors des contrôles. Certaines exceptions subsistent pour les assurés ayant connu l’invalidité ou une incapacité liée au travail, mais elles impliquent des démarches administratives spécifiques et un examen rigoureux par les caisses de retraite.
Ce que change la réforme des retraites sur l’âge de départ
La bascule s’est opérée sans détour : depuis septembre 2023, l’âge légal de départ à la retraite s’éloigne d’année en année, calé sur un planning qui pousse désormais à 64 ans. Que l’on soit salarié, fonctionnaire ou indépendant, nul n’échappe à la règle fixée par décret.
Mais repousser l’âge légal ne suffit plus. Pour prétendre à une pension complète, il faut désormais garantir 43 années d’activité, l’équivalent de 172 trimestres validés. Un coup d’accélérateur : les générations nées dès 1965 sont directement concernées, là où autrefois les mesures s’étendaient sur une durée plus lointaine. Ceux qui pariaient sur le dispositif carrière longue devront aligner tous leurs trimestres, sans blanc ou interruption durable. Le début précoce ne fait plus tout.
Autre volet de la réforme : la mise à niveau du minimum contributif. Pour celles et ceux ayant une carrière complète, le montant minimal de pension vise 85 % du Smic net. Pour autant, la promesse ne couvre pas tout le monde. La réalité, c’est que nombre de retraités à petits revenus restent encore à la marge de ce relèvement.
Quelques avancées tout de même en matière de périodes assimilées : les trimestres validés pour chômage et maternité sont désormais mieux pris en compte, mais ces ajustements ne compensent pas la hausse de l’âge légal. Le débat s’enracine, la vigilance est de mise chez les partenaires sociaux et la Cour des comptes.
Qui peut partir à la retraite à 60 ans ? Les profils concernés
Tenter le départ à 60 ans, aujourd’hui, relève presque de l’exception : la fameuse « carrière longue » sert de sésame. Elle concerne celles et ceux ayant débuté avant leurs 20 ans et totalisant un parcours quasi continu, sans interruption majeure. Concrètement, le nombre de trimestres validés avant une borne d’âge précise, souvent 20 ans, mais cela dépend de l’année de naissance, constitue le véritable filtre.
La liste des profils encore susceptibles de bénéficier d’un départ à 60 ans reste restreinte :
- Les actifs ayant commencé à travailler tôt, avant 20 ans, et justifiant du total de trimestres cotisés demandés peuvent viser un départ anticipé, parfois même avant 60 ans dans des situations très particulières.
- Les assurés reconnus en situation de handicap disposent d’un dispositif spécifique, avec des règles propres sur la durée de cotisation et le taux d’incapacité à atteindre.
Quelques régimes particuliers, comme ceux de la SNCF, de la RATP ou de la Mutuelle sociale agricole, maintiennent des distributions distinctes, même si l’écart avec le régime général se réduit progressivement. La pénibilité, le caractère précoce de l’entrée sur le marché du travail ou les métiers pénibles sont encore considérés, mais franchir la barre reste complexe.
Pour envisager un départ anticipé, il ne suffit pas de consulter son relevé de carrière : il faut s’assurer que les trimestres sont « cotisés ». Ce sont eux qui déclenchent la possibilité de quitter plus tôt : les périodes dites « assimilées » ne suffisent pas toujours.
Décryptage des conditions à remplir pour un départ anticipé
Dès lors qu’on vise le départ à 60 ans, chaque trimestre prend de l’importance. Deux notions clés s’imposent : les trimestres cotisés, c’est-à-dire ceux correspondant à une activité réelle avec versement de cotisations, et la durée d’assurance totale. La différence n’a rien d’anecdotique : certaines périodes, comme le chômage, la maladie ou la maternité, ne comptent que partiellement et sous certaines limites.
Le taux plein, synonyme de pension sans décote, s’obtient seulement en alignant entre 168 et 172 trimestres, soit quarante-deux à quarante-trois années d’activité, selon l’année de naissance. Une carence de trimestres déclenche la décote, tandis qu’un surplus peut générer une surcote.
S’informer sur la nature des trimestres, c’est éviter de mauvaises surprises. Les tableaux récapitulatifs proposés par les caisses retracent ce qui est réellement pris en compte, et dans quelles limites. Les trimestres liés au service national, à la parentalité ou au chômage indemnisé ne suffisent pas facilement à atteindre l’objectif d’un départ anticipé : leur nombre reste contingenté.
Voici un rappel structuré des principales conditions à respecter pour activer le dispositif :
- L’accès à la retraite anticipée suppose un total minimum de trimestres cotisés avant un âge précis, variable selon la date de naissance.
- Les interruptions de carrière rendent plus difficile, voire impossible, l’obtention du droit au départ anticipé.
Privé, fonction publique ou indépendant, la règle reste la même : il faut afficher une carrière dense et sans interruption. Se préparer suffisamment tôt, dès la quarantaine, limite le risque de voir la porte se refermer brutalement pour un simple manque de trimestres cotisés.
Quelles démarches effectuer pour bénéficier d’une retraite à 60 ans ?
Réussir à partir à 60 ans s’anticipe bien avant le grand jour. Première tâche : examiner, ligne à ligne, le relevé de carrière officiel et vérifier que chaque trimestre déclaré correspond bien à une période réelle d’activité. Les oublis ou erreurs, même minimes, peuvent modifier le verdict final. Au besoin, réclamez une correction en faisant valoir vos documents ou bulletins de salaire anciennement archivés.
Ensuite, il faut compléter le formulaire spécifique à la retraite anticipée pour carrière longue, disponible sur le portail national ou auprès de votre caisse par courrier. À joindre systématiquement : tous les justificatifs de cotisation couvrant la période requise. Le dossier, une fois déposé, fera l’objet d’un examen scrupuleux. Ce contrôle approfondi prend parfois plusieurs mois. Pas question de laisser un doute : mieux vaut un document en trop qu’un justificatif manquant.
Ne négligez pas les démarches pour la retraite complémentaire. Les actifs du secteur privé doivent aussi préparer un dossier séparé auprès du régime complémentaire pour synchroniser la liquidation de l’ensemble de leurs droits. Cette étape, souvent oubliée, peut entraîner un décalage dans le versement des pensions si elle est repoussée.
Pour partir en toute sérénité, il reste quelques étapes à caler préalablement :
- Informer l’employeur à temps de sa volonté de quitter l’entreprise, en tenant compte du préavis et des modalités de rupture (fin de contrat ou rupture conventionnelle).
- Vérifier le détail des points acquis pour la retraite complémentaire et signaler toute anomalie pour régularisation.
Un dossier bien ficelé et préparé plusieurs mois à l’avance épargne bien des encombres. Pour celles et ceux qui parviennent à franchir toutes ces étapes avec rigueur, un autre horizon s’ouvre : celui d’une retraite gagnée de haute lutte, sans compromis sur les droits ni regrets administratifs.